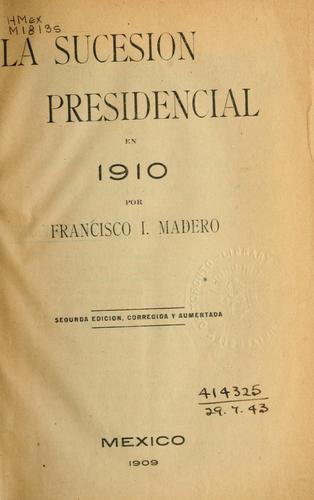FRANCISCO I. MADERO
« Un livre suffit à montrer que
le colosse [Porfirio Díaz] avait des pieds d’argile, La succession présidentielle, écrit par le rejeton idéaliste d’une
grande famille du Coahuila, Francisco I. Madero. Le gouvernement commit une
erreur en le laissant paraître, car il admettait la possibilité de la
révolution et même de sa victoire. Pire, il menaçait César de la révolution ou
cas où il truquerait les élections. » (Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940,
Paris, Tallandier, 1973, p. 31)
« Le
livre de Madero, La succession
présidentielle [1908], était lu partout : tel administrateur de hacienda de Valparaíso (Zacatecas)
réunissait le soir ses travailleurs pour leur en faire la lecture à haute voix
et Madero parcourait le pays, fondant partout des clubs qui avaient pour mot
d’ordre : suffrage respecté, pas de
réélection ! Madero en appelait aux citoyens pour qu’ils
fassent respecter leurs libertés et tel fut le point de départ de la
révolution, qui ne fut le fait ni du désespoir ni de la misère ».
La succession présidentielle en 1910 (1908)
Francisco I. Madero (président du Mexique entre 1911 et 1913)
« En septembre 1911 Madero avait
signé un accord pacificateur, donnant satisfaction aux tribus Yaquis. Zapata se
soulève en novembre 1911, Orozco en mars 1912 et les deux hommes ont des
motivations agraires profondes et incontestables. Les deux sont poussés à la
rébellion par des agitateurs de toutes les tendances : vazquistes qui
dénoncent la trahison de Madero, porfiristes qui ont intérêt à barrer la route
à une révolution politique qui va plus loin qu’il ne semble,
anarcho-syndicalistes qui donnent à Zapata sa devise « Terre et
liberté » et qui dès 1910 dénonçaient la révolution comme « le moyen
criminel dont se sert un groupe d’ambitieux pour prendre le pouvoir »,
catholiques qui lisent le prose enflammée de Sánchez Santos dans El País. Partout la presse, en toute
liberté, traite Madero de fou dangereux et irresponsable entouré de brigands.
Or, les zapatistes et les orozquistes
avaient des motifs sérieux de mécontentement : le licenciement sans
indemnité de révolutionnaires était si peu politique qu’ils les laissait sous
la menace agissante des porfiristes en place et Zapata faillit bel et bien tomber
sous les balles du général Blanquet, un des futurs responsables de la mort de
Madero. Surtout la réforme agraire dont ils avaient, entre les lignes, lu la
promesse dans le plan de Sain Luis, se faisait attendre. L’article 3 prévoyait
la restitution aux villages des terres dont ils avaient été injustement
dépouillés. Mais si Madero comptait rendre cette justice et fomenter
progressivement la petite propriété, il
n’avait pas l’intention de distribuer des terres au prolétariat en divisant les
haciendas […] sans indemnité. » (Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 1973, p.44)
TEXTES DE RICARDO FLORES MAGÓN
Extraits du recueil Propos d'un agitateur, Paris, Libertalia, 2008 (traduction de Michel Velazquez) :
Zapata et
Villa
La rupture qui s’est produite entre Ville et
Carranza, malgré les accords de Torreón, donne lieu à toutes sortes de rumeurs.
L’une d’elles laisse entendre que Villa va s’allier avec le révolutionnaire du
Sud, Emiliano Zapata, pour récupérer la révolution à son seul profit.
Il
y a de l’absurdité dans ce ragot. Nous connaissons tous la sincérité
révolutionnaire d’Emiliano Zapata. Il pratique l’expropriation pour le bénéfice
de tous, tandis que Villa est un chien de la bourgeoisie, prêt à fusiller tout
prolétaire surpris à prendre un bout de pain pour atténuer sa faim. Zapata sait
que l’occupation des terres par les travailleurs, qui entendent la cultiver
sans maîtres, est la seule base possible de la liberté des prolétaires. En
accord avec ses idées, il ne s’oppose pas à ce que les habitants des régions
contrôlées par ses forces s’emparent de la terre et la travaillent, alors que
dans la zone contrôlée par Villa, les peones
n’ont même pas assez de terre pour recouvrir leurs morts.
Évoquer
une union de Villa et Zapata est absurde(*). Villa est un bandit qui protège les
intérêts de la bourgeoisie. Zapata est un révolutionnaire sincère et intègre
qui arrache la richesse des mains de la bourgeoisie pour la rendre à ses
producteurs, les pauvres.
R. Flores Magón, Regeneración, 11 juillet 1914.
(*) Malgré la différence fondamentale entre les deux hommes que
souligne ici Flores Magón, cette union aura bien lieu, pour des raisons
tactiques. Après l’exécution de Zapata en 1919, Villa continuera la lutte jusqu’en
1920, date à laquelle s’étant vu doté d’une hacienda,
il se soumettra au pouvoir. Il sera assassiné en juillet 1923. [Note de l’éditeur.]
Villa et Zapata au Palais National (1914)
Le mendiant
et le voleur
Sur
l’avenue élégante, hommes et femmes se promènent, parfumés, chics et
provocants. Collé au mur, la main tendue, un mendiant quémande d’une voix
tremblante et servile : « Une aumône, pour l’amour de
Dieu ! »
De
temps à autre, une pièce tombe dans la main du mendigot qui s’empresse de
l’enfouir dans sa poche tout en se confondant en louanges et en remerciement
avilissants. Un voleur passant par là ne peut s’empêcher de lui lancer un
regard plein de mépris. Le mendiant s’indigne - la déchéance a ses pudeurs – et
grogne, d’un ton irrité :
« Tu
n’as pas honte, gredin, de regarder en face un honnête homme comme moi ?
Je respecte la loi. Je ne commets pas le délit de mettre la main dans la poche
d’autrui, moi. Ma démarche est sereine, comme tout bon citoyen qui n’a pas coutume
de se faufiler, sur la pointe des pieds, dans les maisons des autres à la
faveur de la nuit. Je n’ai ni à me cacher, ni à fuir le regard du gendarme. Le
nanti se montre bienveillant à mon égard et quand il jette une pièce dans ma
sébile, il me tapote l’épaule en murmurant : '' Brave homme !
'' »
Le voleur, ajustant son
chapeau, grimace de dégoût, lance un regard alentour et réplique au
mendiant :
« N’espère pas me faire
rougir, vil mendiant ! Toi, honnête ? L’honnêteté ne vit pas à
genoux, prête à ronger l’os qu’on daigne lui jeter. Elle est fière par
excellence. Je ne sais si je suis honnête ou non, mais je dois t’avouer qu’il
m’est insupportable de supplier les riches de m’accorder, au nom de Dieu, les
miettes de tout ce qu’ils nous ont volé. Je viole la loi ? C’est vrai,
mais elle n’a rien à voir avec la justice. En violant les lois promulguées par
la bourgeoisie, je ne fais que rétablir la justice bafouée par les riches, qui
volent les autres au nom de la loi. Si je m’empare d’une partie de ce qu’ils
ont pris aux déshérités, je n’accomplis par là qu’un acte de justice. Si le
riche te tapote l’épaule, c’est que ton abjecte bassesse et ta servilité lui
garantissent la pleine jouissance de ce qu’il a volé, à toi, à moi, à tous les
pauvres du monde. Les riches souhaitent ardemment que tous les déshérités aient
l’âme d’un mendiant. Si tu étais vraiment un homme, tu mordrais la main qui te
tend un quignon de pain. Je te méprise. »
Le voleur crache et se perd
dans la foule. Le mendiant lève les yeux au ciel et gémit : « Une
aumône, pour l’amour de Dieu ! »
R. Flores
Magón, Regeneración, 11 décembre 1915.
Emiliano Zapata et Pancho Villa
Ricardo FLORES MAGÓN
Les révolutions nettement politiques n'ont plus
de raison d'être. Il est tout simplement stupide de se tuer pour placer un
homme au pouvoir. À notre époque le culte de la personnalité ne peut faire des
adeptes que parmi les ignorants ou les chasseurs de positions et de rentes.
La
république bourgeoise ne donne plus satisfaction aux hommes intelligents de bonne
foi. La république bourgeoise ne donne satisfaction qu'aux politiciens, à ceux
qui veulent vivre aux dépens du peuple travailleur ; mais à la lumière de la
philosophie moderne, c'est un anachronisme dont l'existence n'est justifiée que
par l'ignorance des masses et la mauvaise foi de celles qu'on appelle classes
dirigeantes de la société.
La
république bourgeoise est un cadavre. Elle mourut dès l'instant où, en faisant
la déclaration des "Droits de l'homme", tout fut garanti sauf
l'égalité sociale des êtres humains, et un cadavre n'a pas le droit de
corrompre l'atmosphère : il faut l'enterrer. Le devoir des vrais
révolutionnaires est de creuser une tombe et y jeter la république bourgeoise.
Le
droit de vivre, voilà ce que nous voulons conquérir, nous, les libéraux ; nous
ne voulons plus des maîtres absolus de la terre d'un côté, et d'esclaves de
l'autre ; nous ne voulons plus de seigneurs féodaux. Les grands propriétaires
veulent vivre de la terre ? Qu'ils la travaillent comme l'ont fait jusqu'ici
les malheureux peones, leurs
esclaves.
Une
révolution qui ne garantit pas au peuple le droit de vivre est une révolte de
politiciens et nous, les déshérités, devons lui tourner les dos. Les pauvres,
nous avons besoin d'une révolution sociale, et non pas d'une révolution
politique ; c'est à dire que nous avons besoin d'une révolution qui donne à
tous, hommes et femmes, la terre que jusqu'ici a été le patrimoine exclusif de
quelques privilégiés de la fortune.
Mais,
il faut que vous le compreniez, le problème doit être résolu par le
prolétariat. Si nous demandons la solution aux classes dirigeantes de la société,
on nous répondra qu'il faut attendre que la paix arrive, jusqu'à qu'un congrès
" décrète " le bonheur des habitants du Mexique, et une fois de plus
dans l'histoire de nos espoirs déçus, nous aurons tenu le rôle, si peu
enviable, de chair à canon.
Non,
le sang coule déjà à torrents, et très bientôt ces torrents se convertiront en
fleuves où seront vidées les vies de beaucoup d'hommes bons, et il faut que ce
gaspillage d'énergie, de vie et de généraux efforts serve à autre chose qu'à
faire monter sur le trône un autre magnat. Il faut que le sacrifice des bons
ait comme résultat l'égalité sociale de ceux qui survivront, et un pas vers
cette égalité est le profit des produits de la terre pour tous ceux qui
travaillent et non pour les patrons. Si les patrons veulent jouir des produits
de la terre, qu'ils empoignent eux aussi la bêche ; qu'ils arrosent eux aussi,
avec leur sueur, la terre jusqu'ici trempée seulement par les larmes, la sueur
et le sang des prolétaires.
L'égalité
face à la loi est une farce ; nous voulons l'égalité sociale. Nous voulons
qu'on nous donne notre chance à tous, non pas pour accumuler les millions, mais
pour pouvoir mener une vie parfaitement humaine sans inquiétudes et sans soucis
pour l'avenir.
Pour
atteindre ces buts, le seul opposant n'est pas Díaz ; le Capital aussi s'oppose
à cela et si les masses choisissent un autre gouverneur, il s'y opposera aussi,
quel que soit son nom et malgré toute sa bonté. C'est pour cela que nous, les
libéraux, nous sommes décidés à changer le cours de l'actuelle insurrection. Le
mal n'est pas un homme, mais le système politique et économique qui nous
domine. Si le mal était un homme, il suffirait de tuer Porfirio Díaz pour que
la situation du peuple s'améliore, mais malheureusement ce n'est pas si simple
que cela. L'odieuse personnalité du dictateur mexicain peut disparaître, mais
le peuple continuera à être esclave : esclave des hommes d'argent, esclave de
l'autorité, esclave de l'ignorance et de la misère. Le sanguinaire tyran peut
disparaître, mais le nouveau président, quel qu'il soit, aura une armée prête à
assassiner les travailleurs qui se mettraient en grève ; les prisons seraient
prêtes à accueillir les victimes, qui auraient commis les délits par la faute
du système social qui nous opprime ; les juges seraient prêts, avec leurs
odieux livres, impitoyables et cruels pour les pauvres, autant qu'ils peuvent
être cléments pour les riches. Le tyran peut mourir ; mais le système
d'oppression et d'exploitation restera vivant et le peuple continuera à être
malheureux.
Comme
je l'ai déjà dit, le gouvernement n'est rien d'autre que le gendarme du
capital, l'épouvantable flic qui garde les coffres forts des vautours des
banques, du commerce et de l'industrie. Pour le capital, il a du respect et lui
est entièrement soumis ; pour le peuple il a les prisons, les casernes et le
gibet.
N'attendons
rien de bon du gouvernement qui s'implantera après cette révolution. Si nous
voulons nous libérer, combattons pour notre cause en prenant possession de la
terre pou la travailler en commun et armons-nous pour défendre nos biens, dans
le cas où un quelconque tyran voudrait nous les enlever.
Groupons-nous, donc, tous les déshérités, sous
les drapeaux égalitaires du Parti Libéral. Contribuons à l'essor de la
révolution libérale, car de sa force dépend la liberté et le bonheur de quinze
millions d'êtres humains.
De
Regeneración, 11 février 1911.
Les illégalistes
Ricardo
FLORES MAGÓN
Le vrai révolutionnaire est par excellence un
hors-loi. Celui qui s'efforce de respecter la Loi sera tout au plus un bon
animal domestique ; mais jamais un vrai révolutionnaire.
La
Loi conserve, la Révolution rénove. S'il faut rénover, il faut donc commencer
par briser la Loi.
Prétendre
que la Révolution peut se faire selon la Loi, est une folie, un contresens. La
Loi est un joug : qui veut s'en libérer doit le briser.
Celui
qui dit aux travailleurs que, tout en respectant la Loi, on peut obtenir
l'émancipation du prolétariat, est un menteur, parce que la Loi ordonne de
laisser aux mains du riche ce qu'il nous a volé. Or, l'expropriation de la
richesse, pou le bénéfice de tous, est la condition sans laquelle il ne peut y
avoir d'émancipation humaine.
La
Loi est un frein et avec des freins, on ne peut attendre la liberté.
La
Loi châtre et les châtrés ne peuvent prétendre à être des hommes.
Les
libertés conquises par l'espèce humaine sont l'œuvre des illégalistes de tous
temps qui saisirent des lois et les déchirèrent.
Le
tyran meurt à coups de couteau et non par les articles de la Loi.
L’expropriation
se fait en piétinant la Loi et non en se laissant écraser par elle.
C'est
pour cela que nous, révolutionnaires, devons forcément être en dehors de la
loi. Nous devons sortir du chemin battu des conventions et ouvrir des voies
nouvelles dans nos vieilles chairs, hors des sillons creusés par les coups de
fouet.
Nous
sommes ici, la torche de la Révolution dans une main et le Programme du Parti
Libéral dans l'autre, pour annoncer la guerre. Nous ne sommes pas de messagers
de paix : nous sommes des révolutionnaires. Nos bulletins de vote seront les
balles que tireront les fusils. À partir de maintenant, les mercenaires du
despote ne trouveront plus la poitrine nue du citoyen exerçant ses fonctions
civiques, mais les baïonnettes de rebelles prompts à rendre coup pour coup.
Il serait insensé de répondre par la loi à qui ne
la respecte pas ; il serait absurde de brandir le Code pour nous défendre des
agressions du poignard et de la "loi de fuite" (1). Ils appliquent la
loi du Talion ? Appliquons-la nous aussi à coups de fusils ! Ils veulent nous
soumettre à coups de fusil ? Écrasons-les nous aussi, à coups de fusils !
Maintenant,
au travail. Que les lâches se retirent : nous n'en voulons pas ; seuls les
braves peuvent s'enrôler pour faire la révolution.
Nous,
nous demeurons à notre poste de combat. La souffrance nous a rendus plus forts
et plus décidés: nous sommes prêts aux plus grands sacrifices. Nous venons dire
au peuple mexicain que le jour de sa libération est proche. Devant nous s'étend
l'aurore splendide d'un jour nouveau ; à nos oreilles résonne la rumeur de la
tempête salvatrice, qui ne va pas tarder à se déchaîner : c'est d'une part
l'esprit révolutionnaire qui fermente, et d l'autre la patrie toute entière qui
est un volcan prêt à cracher le feu qui couve dans ses entrailles. "Plus
de paix", c'est le cri des futurs héros qui flotte au vent, aux premiers
souffles de la tragédie qui s'approche. Un courant de guerre, fort, âcre et
sain, revigore le milieu amolli. L'apôtre de la conspiration annonce d'oreille
en oreille comment et quant se déclenchera la tourmente. Les fusils attendent
impatients le moment où ils sortiront de leur cachette pour étinceler,
hautains, sous le soleil des combats. Mexicains, à la guerre !
Regeneración, 3 septembre 1910.
(1) "Ley de fuga": pratique consistant
à tuer un prisonnier en prétendant qu'il cherchait à fuir (N. d. T.).
Aperçu chronologique
1876-1877
|
Rébellion
de Tuxtepec et accession du général Porfirio Díaz au pouvoir. Le
« Porfiriat » commence.
|
1880
|
Les
chemins de fer mexicains sont reliés aux États-Unis à El Paso (Texas).
|
1884-1911
|
Pouvoir
personnel de Díaz, sept fois réélu.
|
1893-1911
|
Limantour
ministre de Finances.
|
1904
|
Sixième
réélection de Don Porfirio.
|
1907
|
Récession.
|
1910-1925
|
Le
Mexique devient un grand producteur de pétrole.
|
1910-1911
|
La
première phase de la révolution renverse Díaz et assure l’élection de
Francisco I. Madero. Díaz part pour la France.
|
1911
(novembre)
|
Madero
élu président.
|
1913
|
Assassinat
de Madero et du vice-président Pino Suárez (février).
|
1913-1916
|
Deuxième
phase de la révolution mexicaine : succès de Carranza et
d’Obregón ; défaite et marginalisation de Villa et de Zapata.
|
1917
|
Troisième
constitution fédérale.
|
Années
1920-1940
|
Grande
période des peintures murales dans les édifices publics : Diego Rivera
(1886-1957), José Clemente Orozco (1883-1949) et David Alfaro Siqueiros
(1896-1974).
|
1924-1934
|
Suprématie
(Maximato) de Calles.
|
1926-1929
|
Guerre
des « cristeros », soulèvement de 50 000 paysans contre la politique
antireligieuse du président Calles.
|
1929
|
Défaite
électorale de Vasconcelos.
|
1934-1940
|
Lázaro
Cárdenas président.
|
1937-1938
|
Crise
du pétrole. Nationalisation des compagnies pétrolières.
|
Années
1940-Fin des années 1960
|
Expansion
économique : le Mexique devient surtout urbain. Les anciens partis
officiels PNR (1929-1938) et PRM (1938-1946) deviennent le PRI, qui détient
le pouvoir jusqu’en 2000.
|
Bibliographie sommaire
-Azuela,
Mariano, Ceux d’en bas, Paris,
Ed. Les Fondeurs de Briques, 2007.
-Casasola, Agustín, Historia
gráfica de la revolución 1900-1940, 5 vol., Mexico, 1940, réédité depuis
1964.
-Córdova, Arnaldo,
La ideología de la revolución
mexicana, Mexico, Era, 1992.
-Fuentes,
Carlos, La mort d’Artemio Cruz,
Paris, Gallimard, 1992.
-Guzmán,
Martín Luis, L’ombre du Caudillo,
Paris, Gallimard, 1959.
-Halperin
Donghi, Tulio, Histoire contemporaine de
l’Amérique latine, Paris, Payot, 1972.
-Hamnett,
Brian, Histoire du Mexique, Paris,
Perrin, 2009.
-Meyer,
Jean, La révolution mexicaine 1910-1940,
Paris, Tallandier, 1973.
LE «PORFIRIAT »
1. « Don Porfirio Díaz, à partir de sa deuxième présidence (1884-1888) se proposa deux objectifs, économique et politique, le progrès dans l’ordre. Au cours de cette présidence il mit au point le système qui lui permit de rester le maître jusqu’en 1910. Il forma un cabinet composé de diverses tendances, réconciliant catholiques et protestants, jacobins et impérialistes ; lors de sa première présidence il avait utilisé vingt-deux ministres différents, il n’y eut pas un seul changement de portefeuille entre 1884 et 1888, grâce à son habileté. Il en fit preuve encore dans ses relations avec les gouvernements des États, personnages clefs du mécanisme politique : alors qu’il y avait huit candidats au gouvernement du Jalisco, Díaz parvint à obtenir l’appui de tous pour y placer son homme. Alors qu’en 1880, il y avait eu six candidats à la présidence, en 1884 Don Porfirio fut le seul à se présenter et il se fit réélire sans problème jusqu’en 1910. Tacticien remarquable, usant les factions les unes contre les autres, intégrant au système tous les hommes nouveaux, il gouverna avec un minimum de terreur, selon le dicton devenu célèbre " le général étrangle sans pendre ". De l’administration et pas de politique, du pain et du bâton, telles sont les définitions lapidaires qu’il a données de son programme.
Les problèmes de la démocratie
parlementaire ne concernaient guère le peuple, puisque les élections touchaient
20 000 votants ; les paysans, politiquement isolés, faute des communications entre leurs villages, sont
encore neutralisés par leur analphabétisme[1] ;
le village est un isolat politique, sauf pour les chefs. Seule une très petite
minorité, rancheros et curés de
campagne, entre autres, a une conscience politique et les moyens de participer
à cette activité écrite qu’est la politique. »
[1] 76,9 % d’analphabètes en 1910 ; moyenne nationale qui va de 43 % pour la capitale, à 90 % pour le Guerrero.
Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 1973, p.
26.
Porfirio Díaz
2. « La
comparaison entre le Mexique et le reste de l’Amérique latine montre bien
quelles ont été les conséquences des
mesures politiques adoptées durant la période Díaz. L’expérience de gouvernement
représentatif commencée en 1855
prit fin après 1884. Si imparfaite et limitée fût-elle, l’intention n’était ni
de la réformer ni de la renouveler, mais de l’anéantir. Bien des commentateurs
ont interprété le régime de Díaz (encore controversé) au regard de ses propres
autojustifications. À l’époque, ses partisans le justifiaient au motif que la
constitution de 1857 ne fonctionnait pas, que le peuple mexicain n’était pas
prêt pour un gouvernement représentatif –ou en était incapable-, que la dictature
était nécessaire au développement et que Juárez et Lerdo, qui voulaient se maintenir au
pouvoir, avaient posé les bases du régime de Díaz. L’autre argument était que
seul Díaz pouvait faire tenir ensemble le pays. Cependant, le Mexique produisit
beaucoup de personnalités éminentes et compétentes […] aptes à briguer la
présidence. Le régime de Díaz ne fut pas le résultat de conditions historiques
ni d’un simple accident, mais de décisions prises au plus haut niveau. Le pays
qui, durant l’ère de la Réforme, avait été à l’avant-garde du progrès politique
en Amérique latine, retomba petit à petit au niveau de sociétés moins avancées.
[…] L’expérience Díaz, baptisée « Porfiriato » par Daniel Cosío
Villegas, priva les Mexicains des quelques garanties constitutionnelles qu’ils
avaient obtenues depuis la fin de l’ère coloniale. Les expériences
constitutionnelles, commencées en 1808, furent brisées. La pratique politique
ne reposa plus, dès lors, sur le respect de la Constitution, mais sur des
accords personnels avec le général Díaz. Or de tels procédures violaient les
préceptes fondamentaux d’impartialité constitutionnelle jadis défendus par
Juárez ».
Hamnett, Brian, Histoire
du Mexique, Paris, Perrin, 2009, pp. 192-193.
Caricature de Porfirio Díaz parue dans El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)
Protestation dans les locaux du journal satirique El Hijo del Ahuizote (1903)
3. « [Les] progrès vont de pair avec le triomphe de l'autoritarisme politique. En 1880, Díaz avait cru bon
de respecter le thème révolutionnaire de la non-réélection et de se donner pour
quatre ans un successeur docile ; à partir de 1884 il reste à la présidence,
jusqu'en 1911. Il construit un appareil politique sûr et pour compter sur
d'inconditionnels fidèles il dégrade progressivement la qualité su personnel
politique; à la fin de son règne il traitera ses parlementaires de chevaux (la
caballada). Il sut marcher assez lentement vers la dictature à vie pour
vaincre toutes les résistances, et elles furent faibles. […] Pour Justo
Sierra, le plus doué et le plus éminent idéologue du régime, le Mexique de Díaz
est le Mexique métis, synthèse du passé indien et du passé espagnol. Pour le
régime lui-même, c'est un Mexique toujours plus européen, ou que l'on voudrait
tel. Lors de grandes fêtes on écarte la gent d'aspect trop indigène des rues
principales de la capitale pour que les illustres visiteurs n'aient pas une
idée tendancieuse du pays. Cette attitude n'est pas neuve, mais neuve la justification raciste que l'on donne. »
Halperin Donghi, Tulio, Histoire contemporaine de l’Amérique latine,
Paris, Payot, 1972.
Couverture de El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)
Couverture de El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)